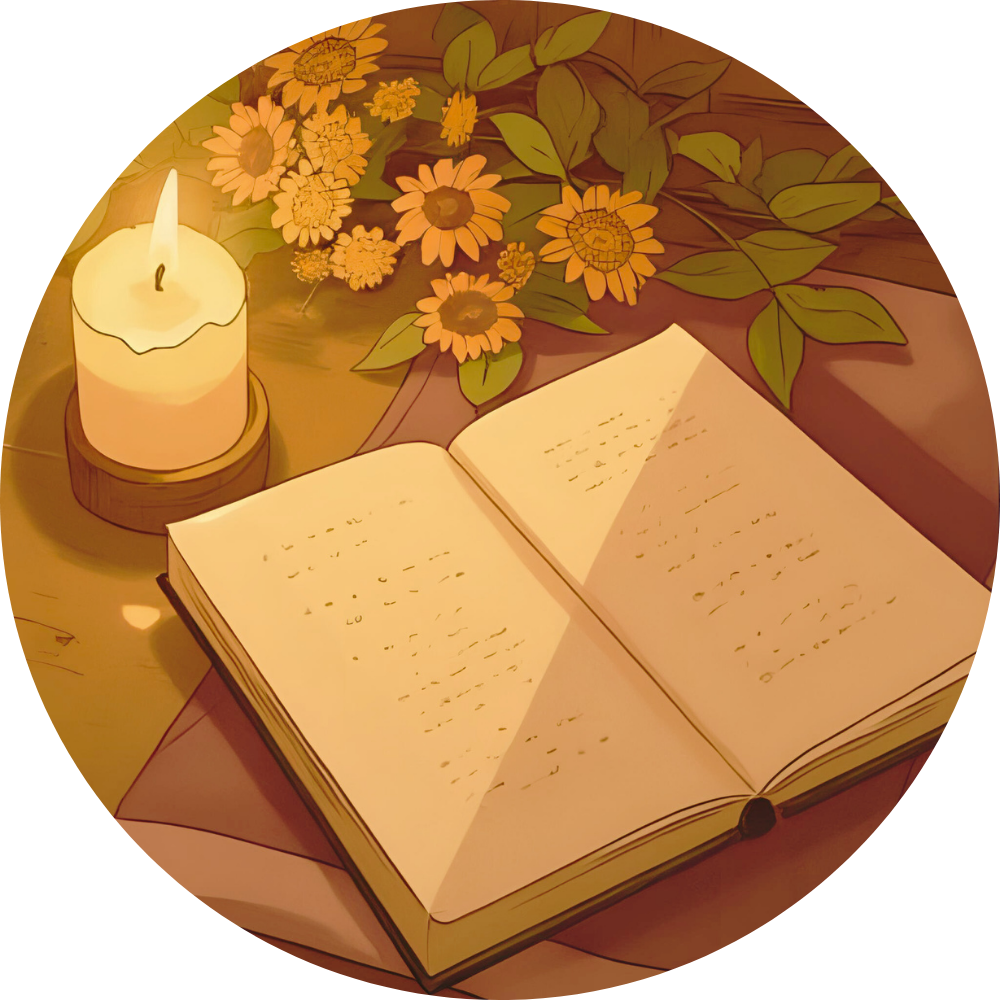
Pourquoi écrire l’histoire familiale, c’est aussi lutter contre l’effacement des mémoires
On croit souvent que l’histoire familiale, c’est une affaire privée.
Des dates, des anecdotes, quelques photos jaunies dans une boîte à chaussures.
Mais écrire son histoire familiale, ce n’est pas simplement remettre de l’ordre dans un arbre généalogique.
C’est résister à l’oubli.
C’est refuser que les vies passées s’effacent sans un mot.
🧩 Il y a mille façons d’exister dans les archives… et tout autant de façons d’en disparaître
Des femmes dont on a seulement gardé le nom de jeune fille.
Des enfants abandonnés devenus invisibles.
Des ancêtres oubliés, car “il n’y avait rien d’intéressant à raconter sur eux”.
Mais justement :
écrire sur eux, c’est affirmer qu’ils ont compté.
Qu’ils ne sont pas juste un nom sur un acte ou une case à cocher dans un arbre généalogique.
✍️ L’écriture comme acte de mémoire
Quand j’ai commencé à écrire sur mon arrière-grand-père, je voulais d’abord comprendre.
Puis, je me suis rendu compte que ce que je faisais, c’était transmettre.
Une mémoire. Un regard. Un lien entre les générations.
C’était dire : “Tu n’es pas oublié.”
Et à ceux qui lisent aujourd’hui : “Tu viens de quelque part. Tu fais partie d’une histoire.”
📖 Mon livre, c’est ça : un pont entre les silences et le souvenir
Écrire l’histoire familiale, c’est un geste intime et politique à la fois.
C’est tenir tête à l’effacement, avec des mots, des images, de la tendresse.
👉 Ce livre, c’est ma manière de participer à cette mémoire collective.
À découvrir ici : Mon livre Pupille
Cet article n'a pas encore de commentaire.
Un commentaire ou une question ?
Tous les commentaires sont modérés avant la publication.